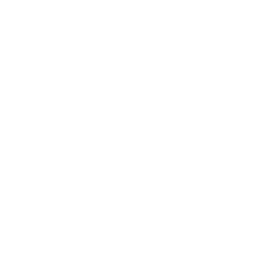Au départ, tout semblait aller pour le mieux. Mais peu à peu, la pression de la direction s’est intensifiée. Pour éviter les erreurs et rassurer ses supérieurs, Claire a commencé à tout contrôler : relire les mails avant envoi, corriger les présentations, multiplier les réunions de suivi.
Ses intentions étaient sincères : protéger son équipe, éviter les fautes et montrer que tout était sous contrôle. Pourtant, l’effet fut inverse : les visages se sont fermés, les idées ont cessé d’émerger, les initiatives ont disparu. En trois mois, deux départs, un arrêt maladie et une phrase lourde de sens: Claire n’était pas devenue autoritaire par goût du pouvoir, mais par peur de l’échec. Elle est tombée dans un piège fréquent : celui d’une culture du résultat sans respiration, où l’exigence et la peur prennent le pas sur la confiance et le sens.
Le management toxique : un produit du système plus que des individus
On associe souvent la « toxicité managériale » à des personnalités difficiles. Pourtant, dans la plupart des cas, ce n’est pas la malveillance qui est en cause, mais un système qui dérive.
C’est une culture du « toujours plus », des urgences permanentes et de la performance à tout prix, qui pousse les managers à adopter des comportements contreproductifs :
- Fixer des objectifs flous mais exigeants, sans cap partagé ;
- Évaluer sans écouter ;
- Ne donner de feedback que lorsqu’il y a un problème ;
- Multiplier les indicateurs de performance (KPI) sans jamais mesurer l’impact humain ou collectif.
Le système valorise la productivité, mais oublie de mesurer la qualité du lien, la coopération, la créativité, bref, tout ce qui fait la vitalité d’une équipe.
Comme le rappelle Simon Sinek dans une conférence devenue célèbre, les organisations qui négligent la confiance et la sécurité psychologique finissent par éteindre la motivation intrinsèque de leurs collaborateurs.
Pourquoi ce type de management existe encore (et même davantage) en 2025?
Parce qu’il fonctionne à court terme. Les chiffres montent, les mails fusent, les réunions s’enchaînent. Tout semble tourner vite et bien. Mais cette efficacité est illusoire.
À long terme, les effets sont dévastateurs : désengagement, départs, burn-out, perte de confiance, et une image d’entreprise qui se dégrade.
Dans un contexte de pénurie de talents et de compétences, cette spirale devient dangereuse. Les organisations peinent à recruter et à fidéliser, car les collaborateurs recherchent désormais un environnement où ils peuvent s’épanouir, pas seulement performer.
Le rôle clé des RH : gardiens de la santé organisationnelle
Face à ce constat, la fonction RH n’est plus un simple service support : elle devient le pilier de la santé organisationnelle.
Un management toxique ne fait pas souffrir que les collaborateurs, il épuise aussi les managers eux-mêmes. Beaucoup ne souhaitent pas « mal faire », mais reproduisent des modèles hérités ou cèdent à la pression d’une culture qui valorise le résultat avant tout.
Le rôle des ressources humaines est donc central :
– Ouvrir les yeux de l’organisation sur ses propres dérives, sans chercher de coupables ;
– Former et soutenir les managers bien intentionnés mais démunis ;
– Créer des espaces de dialogue, où les signaux faibles remontent avant de devenir des crises ;
– Protéger les managers non toxiques, ces femmes et ces hommes qui maintiennent un cap humain malgré la dureté de leur environnement.
Une DRH lucide et courageuse ne cherche pas à étouffer les tensions, mais à les transformer en apprentissage collectif.
Elle joue un rôle d’alerte, de régulation et de transformation.Et lorsque les situations dépassent ses moyens internes, elle peut s’appuyer sur des partenaires spécialisés capables d’accompagner ces changements en profondeur.
C’est là qu’intervient Quilotoa.
Transformer durablement les pratiques managériales
Sortir d’un management toxique ne se décrète pas à coups de slogans sur la « bienveillance » ou la « qualité de vie au travail ».nLa transformation repose sur des fondations concrètes : une communication authentique, une culture du feedback, une exemplarité incarnée.
Et surtout, cela demande du temps, du courage et une méthode éprouvée.
C’est précisément la mission de Quilotoa : aider les entreprises à rebâtir des pratiques managériales saines et durables, en agissant à plusieurs niveaux :
– Diagnostiquer les comportements à risque, sans stigmatiser ;
– Former les managers à une communication claire, constructive et régulatrice ;
– Installer des rituels de feedback et de reconnaissance qui ancrent de nouvelles habitudes.
L’exemple du Groupe Rocher : replacer la parole au cœur du management
En collaboration avec le Groupe Rocher, Quilotoa a accompagné l’ensemble des strates managériales, de la direction aux managers de terrain, dans la création d’une culture du feedback alignée avec les valeurs du groupe.
L’objectif : réapprendre à parler vrai. Donner, recevoir et intégrer les retours sans jugement.
Résultat : des managers plus alignés, des équipes plus sereines, et une culture de l’exemplarité diffusée naturellement dans toute l’organisation.
Aujourd’hui, malgré un contexte économique tendu, 74 % des collaborateurs du Groupe Rocher se déclarent fiers de travailler pour leur entreprise, désireux d’y rester et heureux dans leur environnement professionnel.
Un chiffre qui parle de lui-même : quand la parole circule, la confiance revient.
En conclusion : réinventer le management pour réconcilier performance et humanité
Le management toxique n’est pas une fatalité. C’est un symptôme : celui d’organisations qui ont oublié que la performance durable repose avant tout sur la confiance, la reconnaissance et le sens.
En 2025, les entreprises les plus résilientes ne seront pas celles qui exigent le plus, mais celles qui écoutent le mieux.
Celles qui savent que la santé managériale est un indicateur de réussite aussi essentiel que le chiffre d’affaires.
Et si, au fond, la vraie performance consistait à créer des environnements où chacun peut à la fois contribuer, grandir et respirer ?